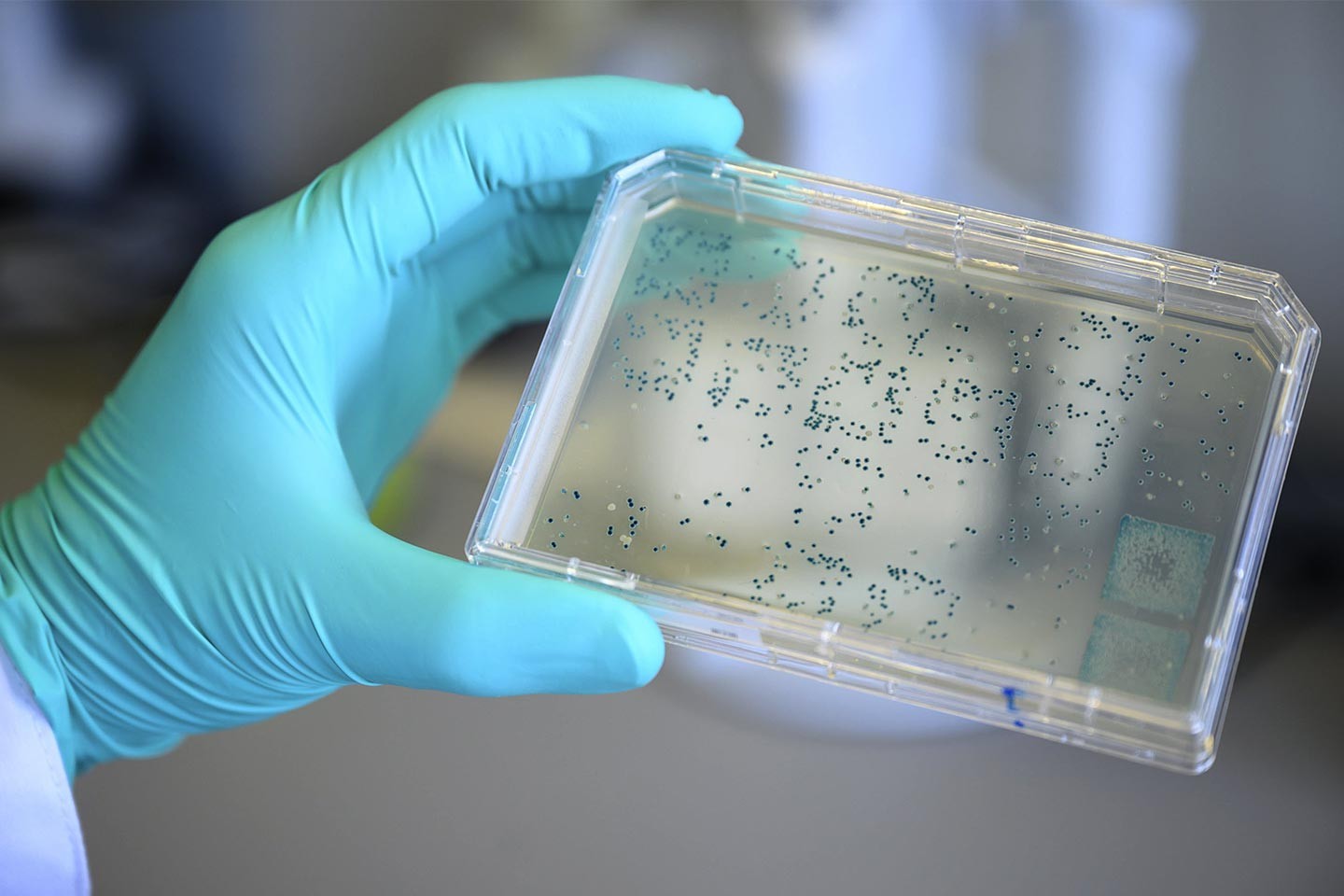«L’ARN messager est arrivé dans la vie de tout le monde comme un ouragan ! », constate Steve Pascolo. Lui, en revanche, a eu le temps de voir le vent se lever. Depuis plus de vingt ans, ce chercheur français travaille sur l’ARN messager synthétique
Avant de devenir le sujet de conversation de la fin 2020, l’ARN, infiniment moins connu que son cousin l’ADN, était complètement ignoré du grand public. L’ADN ne serait pourtant pas grand-chose sans lui. L’ADN, c’est le détenteur de l’information génétique et des « plans de construction » de tout notre organisme. Ultraprécieux, il reste protégé dans le noyau de la cellule, dont il ne sort pour ainsi dire jamais. Mais il doit pourtant faire passer ses directives à la cellule. Pour cela, il a besoin d’un messager : c’est l’ARN. Alors que l’original du code génétique