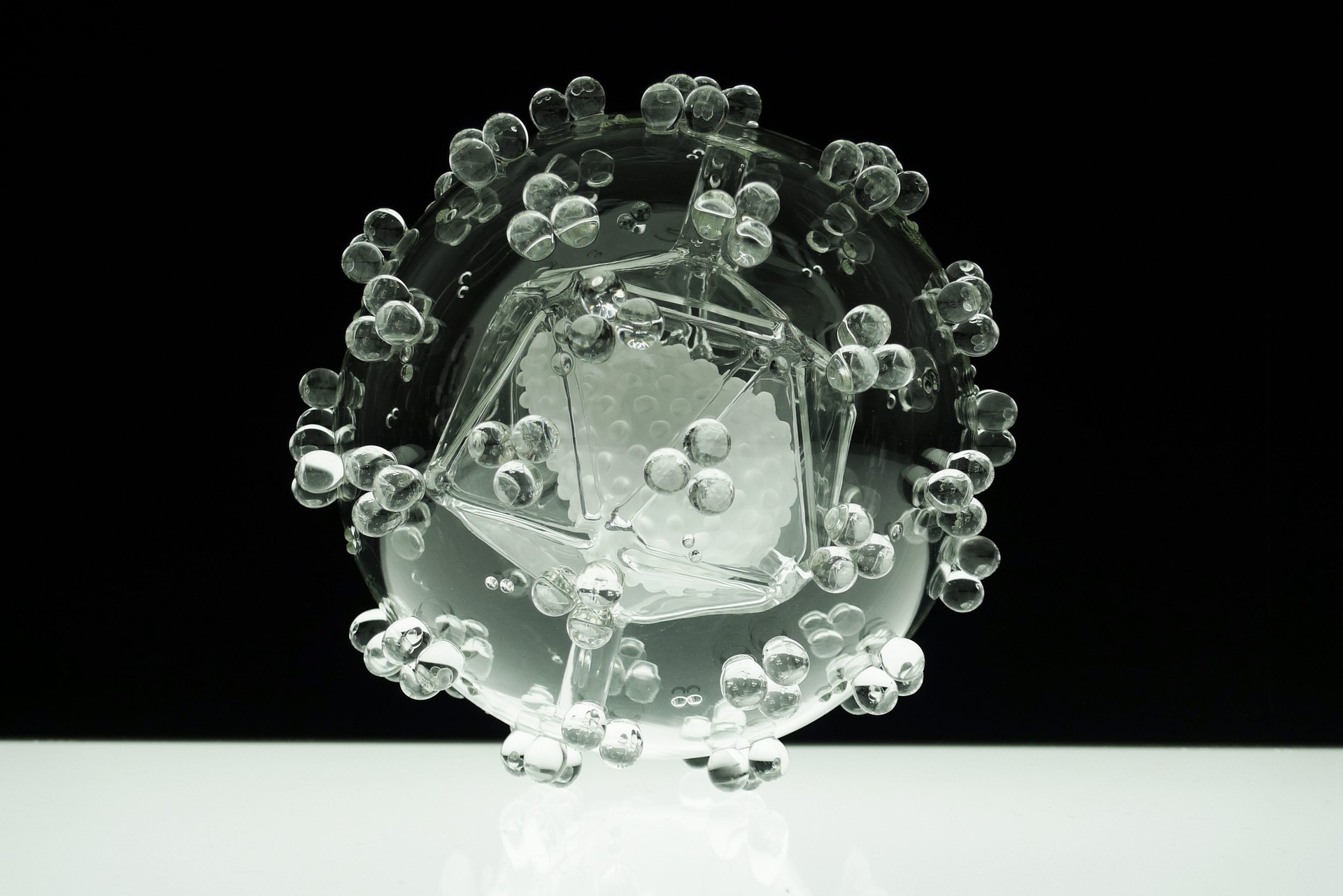Washington, D.C., 23 avril 1984. Margaret Heckler, secrétaire d’État américaine à la Santé, se présente devant une nuée de journalistes pour tenir une conférence de presse. Trois ans auparavant, les premiers cas de sida sont apparus aux États-Unis. Aucun traitement ne permet encore d’empêcher les malades de mourir et la panique monte. Robert Gallo, célèbre chercheur en virologie, se tient à ses côtés. « D’abord, la cause probable du sida a été trouvée », annonce Margaret Heckler ce jour-là. Avant d’ajouter que les avancées sur la caractérisation du virus permettront de « développer un vaccin pour prévenir le sida dans le futur ». « Un tel vaccin sera prêt à être testé dans environ deux ans [ … ] Une autre maladie terrible est sur le point de céder à notre patience, à notre persévérance et à notre génie », prédit-elle même. Quarante ans après, le sida est devenu une maladie chronique grâce aux trithérapies. Mais aucun vaccin n’a pu être mis au point malgré de réguliers effets d’annonce. Pourquoi un tel échec, à ce jour, alors que non pas un mais plusieurs vaccins contre le Covid-19 ont été développés en moins d’un an ? La question est souvent soulevée par les antivax et autres suspicieux, qui pensent voir dans ce décalage la preuve que les vaccins disponibles contre le coronavirus ont été conçus et produits à la va-vite.
Mauvaise piste. Le Sars-Cov-2 et le VIH ont beau être deux virus à ARN, ils n’ont que très peu à voir l’un avec l’autre.