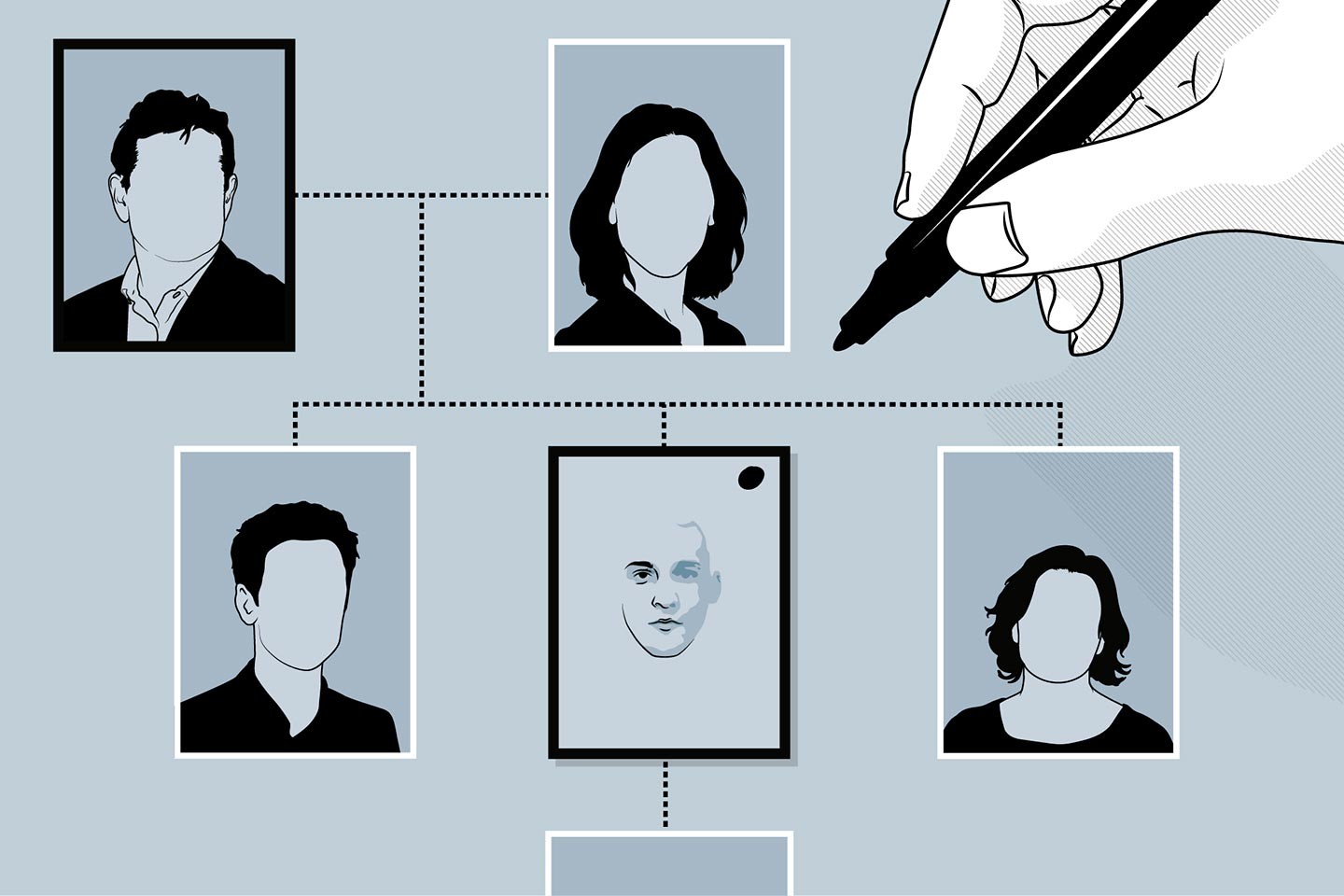Un corps en partie calciné. Un mégot. Un préservatif usagé. La scène de crime présentait de sérieux indices. L’affaire a pourtant bien failli rester un « cold case ». Les faits : dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, à 0 h 21, Élodie Kulik, 24 ans, directrice d’une agence bancaire à Péronne dans la Somme, appelle les pompiers au secours. La communication est brusquement interrompue après des hurlements. Une demi-heure plus tard, son véhicule, une Peugeot 106 rouge, est signalé accidenté à quelques kilomètres avant Péronne sur la D45. Le lendemain, un agriculteur découvre la dépouille carbonisée d’Élodie Kulik dans une décharge sur la petite commune de Tertry, toujours dans la Somme. À ses côtés, un mégot et un préservatif.
Les indices placés sous scellés sont acheminés à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), alors à Rosny-sous-Bois, dont le colonel Christian Fillon est actuellement le directeur adjoint. Banco : les scientifiques trouvent des traces d’ADN du suspect (et de la victime) sur le mégot et surtout dans le préservatif. Le sperme est particulièrement riche en ADN. Le département de biologie établit le profil génétique de l’homme. Las. Le « code-barre » du suspect tape dans le vide lorsqu’il est comparé à celui des criminels ou délinquants enregistrés dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). L’homme qui a violé Élodie Kulik est un inconnu. L’affaire ne va pas être simple à résoudre.
Lorsque je suis nommé responsable de la division “atteintes aux personnes”, mon chef Robert Bouche me dit : “Je ne pige rien à tes histoires d’ADN, mais j’ai besoin qu’un œil neuf se penche sur le dossier Kulik.”
2002, toujours : à Toulouse, le jeune étudiant en ingénierie de la santé Emmanuel Pham-Hoai, mordu de biologie, s’intéresse alors davantage à l’affaire du tueur en série Patrice Alègre qu’au meurtre de celle qu’on appelle « la banquière de Péronne ». C’est pourtant lui qui, dix ans plus tard, va largement contribuer à mettre un nom sur le fameux code-barre.
Affable, petit accent béarnais, le lieutenant-colonel Pham-Hoai, 42 ans, qui a pris l’été dernier le commandement de la compagnie des Andelys, dans l’Eure, accepte de replonger dans l’affaire. Et ce malgré l’âpre souvenir d’avoir un temps été traité de « Dr Frankenstein de la génétique » durant son enquête et malgré une certaine fatigue : il est en pleine rédaction d’une thèse sur l’expertise génétique qu’il soutiendra bientôt à huis clos et qui restera confidentielle. Sujet stratégique et sensible, à l’heure où l’ADN est souvent hissée au rang de « reine des preuves » et où violeurs, tueurs et voleurs s’efforcent d’effacer leurs traces.

Dans ses travaux de recherches, le lieutenant-colonel Pham-Hoai consacre un chapitre entier à l’affaire Kulik. Celle qui a fait de lui un expert consacré dans les cours d’assises. En 2009, après avoir dirigé le laboratoire de biologie de l’IRCGN, sonne pour lui l’heure du terrain : il intègre la section de recherches d’Amiens. « Un an plus tard, lorsque je suis nommé responsable de la division “atteintes aux personnes”, mon chef Robert Bouche me dit : “Je ne pige rien à tes histoires d’ADN, mais j’ai besoin qu’un œil neuf se penche sur le dossier Kulik.” Bouche, il est un peu comme l’entraîneur Didier Deschamps. Il tente. Je ne suis pas Mbappé ou Neymar, mais je m’immerge dans l’affaire. En termes d’enquête policière, tout a été fait. » Pas d’oubli. Pas de négligence.
Au moins 10 000 personnes ont été entendues et près de 600 hypothèses suivies sans succès. Depuis 2002, quelque 5 000 Picards ont fait l’objet de prélèvements buccaux. En vain. Aucun ADN ne « matche » avec celui du suspect. « Après avoir tout épluché, retrace le gendarme, je me dis : soit il s’est enfui à l’étranger, soit il s’est rangé et n’a commis aucune infraction depuis le meurtre

Emmanuel Pham-Hoai resserre maintenant son exposé. Et raisonne : « Le suspect a forcément eu un père et une mère. » Et, comme tout le monde, a hérité de 50 % du patrimoine génétique de son père et 50 % de sa mère. Le reste tient du pari : « Si le profil du meurtrier d’Élodie Kulik n’est pas dans notre fichier, peut-être que l’un de ses ascendants ou descendants y est. » Il mouline. Le scientifique prend une décision : « Au lieu de chercher 100 % de correspondance entre la trace dont nous disposons et celles qui sont enregistrées dans le Fnaeg, je vais chercher seulement 50 % de correspondance. À l’époque, je pensais que cela se faisait. Mais non. Je demande donc la permission au ministère de la Justice de procéder ainsi. » La technique est inédite en France. Aucun cadre juridique n’existe.
La demande d’autorisation part. Dans l’attente, le gendarme scientifique effectue des recherches bibliographiques, avec ce postulat. « Je sais que je ne suis pas Einstein et si j’ai eu cette idée, c’est que quelqu’un d’autre l’a eue avant moi. » Les Américains, de fait, utilisent déjà cette technique dite de « recherche ADN en parentèle » ou « familial search ». « J’ai alors contacté des scientifiques américains, notamment le biologiste Greg Hampikian. » Ce très grand expert en ADN médico-légal dirige l’Idaho Innocence Project de l’université d’État de Boise. La mission qu’il s’est fixée ? Démontrer l’innocence de personnes condamnées par erreur en ayant recours à des contre-expertises fondées sur des tests ADN. Emmanuel Pham-Hoai contacte aussi « le procureur du Colorado, qui utilise cette méthode même pour de simples vols ». Il suit également de près l’affaire Grim Sleeper (« dormeur lugubre »), surnom de Lonnie David Franklin Jr, tueur en série californien du milieu des années 1980, qui s’est « rangé » entre 1988 à 2002 (d’où son surnom de dormeur). Le lugubre Franklin Jr a fini par être identifié et arrêté en 2010. Son fils avait été fiché suite à une arrestation pour possession illégale d’armes. Et son ADN s’est révélé proche de celui retrouvé sur le corps des victimes du « dormeur ». Mais c’est une autre histoire…
Je lui demande de faire un prélèvement. Il me dit qu’au moment des faits, il était en prison, ce qui est exact. Mais il accepte, il veut bien aider. Je me plonge alors dans l’état-civil de la famille.
Après une année de réflexion, la chancellerie finit par autoriser le lieutenant-colonel Pham-Hoai à procéder à son essai, puisque juridiquement, rien ne s’y oppose. Début de l’opération : « Aujourd’hui, le Fnaeg est tout automatisé, ce serait allé plus vite. Mais là, c’était la première fois. Il a fallu une semaine de travail à temps plein pour que le super-algorithme donne ses résultats », raconte-t-il avec une certaine fougue. De fait, chercher dans la base des correspondances sur la moitié seulement du profil génétique démultiplie les résultats possibles. Et ? Le fichier trie par marqueurs génétiques analysés. 526 personnes sont proposées. Ça fait beaucoup. « En se basant sur 16 marqueurs, on tombe à 292 candidats. La trace que nous avions en comptait 18, ce qui est vraiment pas mal. Quand on retrouve de l’ADN, nous n’avons pas toujours les 21 marqueurs. En tout cas, en mettant le curseur à 18 marqueurs, nous n’avions plus qu’un seul candidat présentant 50 % de correspondance avec la trace du suspect. » Et enfin un nom : Patrick Wiart, fiché car condamné pour agression sexuelle, en 2001, à trois ans de prison dont un avec sursis.

Patrick Wiart habite en Picardie. Le gendarme Pham-Hoai décide d’aller le voir. « Je lui demande de faire un prélèvement. Il me dit qu’au moment des faits, il était en prison, ce qui est exact. Mais il accepte, il veut bien aider. Je me plonge alors dans l’état-civil de la famille. » Sont écartés : le père de Patrick Wiart (il est décédé en 2002) et le fils de ce dernier, qui avait 5 ans au moment du meurtre d’Élodie Kulik. Ne reste plus qu’une piste, celle du fils aîné de Patrick Wiart : Grégory Wiart, plombier-chauffagiste, mort en 2003 dans un accident de voiture.
L’ADN de la mère de Grégory est alors prélevé. « Comme un billet de banque que l’on a déchiré, les deux pièces s’assemblent. » Il est plus que probable que l’homme décédé soit l’auteur de la trace de sperme retrouvée dans le préservatif. Le plus logique serait alors d’exhumer le corps pour vérifier. Mais patience, Grégory Wiart n’est pas le seul impliqué dans l’affaire Élodie Kulik. Dans l’enregistrement de l’appel de la jeune banquière aux pompiers peu avant sa mort, on distingue au moins deux voix d’hommes avec un fort accent picard. « J’ai demandé au juge d’instruction de ne pas exhumer le corps tout de suite, car je ne voulais pas éveiller les soupçons et provoquer une envolée de moineaux [comprendre d’éventuels suspects, ndlr] », se souvient le gendarme, qui souhaite alors protéger l’enquête classique de terrain qui reprend. Tout l’entourage de Grégory Wiart, et particulièrement sa bande d’un club de 4x4, est systématiquement interrogé. Le 16 janvier 2013, Willy Bardon, ancien plombier et tenancier de bar, est mis en examen. Plusieurs témoins ont reconnu sa voix sur la bande sonore de 26 secondes. Suffisant ? Onze ans après le meurtre d’Élodie Kulik, il est condamné à trente ans de réclusion criminelle. À l’annonce du verdict, Willy Bardon tente, en vain, de mettre fin à ses jours en avalant un pesticide très toxique. Puis il fait appel. En septembre dernier, la cour d’appel de Douai (Nord) a accédé à sa troisième demande de remise en liberté.
Fin janvier 2012, le corps de Grégory Wiart est exhumé. Son profil génétique « correspond » avec celui de l’ADN retrouvé dans le préservatif, comme on dit avec prudence à l’IRCGN. Non, Emmanuel Pham-Hoai n’a rien d’un Dr Frankenstein de la génétique et la recherche par parentèle, tentée pour la première fois en France, n’est pas une fumisterie. Celui qui est alors capitaine a du potentiel. On l’a repéré. Sa hiérarchie l’envoie pendant trois mois à l’académie du FBI, le renommé Bureau fédéral d’investigation, à Quantico, dans l’État de Virginie. Il enchaîne avec une mission de six mois, toujours avec le FBI, à Kaboul.

Suite à l’affaire Kulik, un protocole est mis au point pour autoriser la recherche ADN par parentèle. Seulement en cas de viol ou d’homicide, et à partir d’un profil génétique contenant au moins 16 marqueurs. Depuis 2016, cette technique est inscrite dans le code de procédure pénale. Il faut dire qu’elle a ouvert de nouvelles perspectives. Un exemple ? Après quasi deux décennies d’enquête (l’affaire a même été un temps classée), un homme de 45 ans, surnommé le « violeur de la forêt de Sénart », a fini par être « coincé » par l’ADN de l’un de ses frères. Il a été condamné le 8 octobre à vingt ans de prison pour 32 faits de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles. L’expertise génétique aussi a progressé : « Au début des années 2000, il nous fallait environ 1 000 cellules. Aujourd’hui, huit cellules de bonne qualité suffisent », précise le scientifique. La panacée ?
Emmanuel Pham-Hoai rebouche son feutre et lâche : « À l’époque, je ne mesurais pas l’ampleur que cette recherche en parentèle pourrait avoir. » Sans la minimiser, il nuance. L’ADN n’est pas toujours bavard. Il peut avoir été dégradé par des moisissures d’humidité, des variations de température ou des rayonnements ultraviolets. Il peut être si mélangé à d’autres qu’il en devient, selon le scientifique, « une omelette » illisible. Même quand deux profils génétiques « matchent », les biologistes de l’IRCGN s’évertuent systématiquement à chiffrer « la probabilité de coïncidence fortuite », même lorsqu’elle est infime, de l’ordre de 1 sur 1 milliard. Pour Emmanuel Pham-Hoai qui, dans sa thèse, travaille à une amélioration des protocoles, « l’ADN n’est pas la reine des preuves. L’ADN n’est qu’une preuve parmi d’autres ». Et c’est lui, l’expert de l’ADN, qui le dit : « Une belle empreinte digitale sur une arme à feu, quoi de mieux ? »