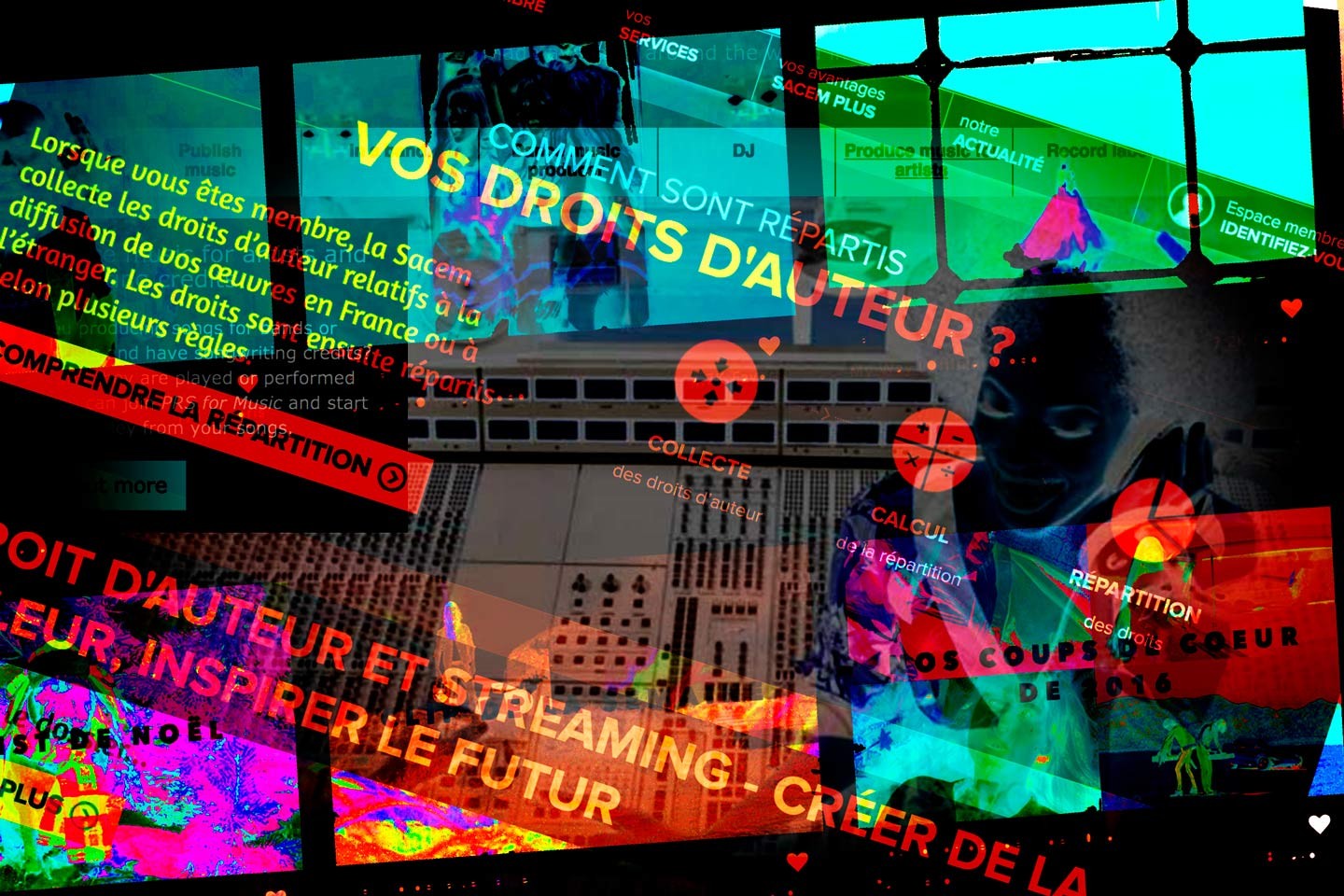J’ai expliqué dans l’épisode précédent comment les industries des loisirs ont sauté sur une réforme européenne portant sur la circulation des œuvres en ligne pour défendre agressivement leur vision du business : un monde fermé, où rien sur internet ne doit circuler sans l’approbation des gestionnaires de droits de propriété intellectuelle. Leur cible principale est l’un des sites les plus fréquentés du monde, YouTube, dans le collimateur parce qu’il ne rapporte pas assez aujourd’hui alors que près d’un milliard d’humains l’utilisent chaque mois.
Cette bataille, qui va définir notre accès à une bonne partie de la culture audiovisuelle pour la prochaine décennie au moins, se joue dans un texte aussi subtil que soporifique : la proposition de directive de la Commission européenne « sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ».
L’article 13 de cette proposition focalise en particulier le conflit entre YouTube et les industries du cinéma et de la musique. Écrit sous la pression des lobbies et bien loin de l’esprit de l’objectif premier du texte, il prévoit que « les prestataires de services […] qui stockent un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs », doivent prendre « des mesures destinées […] à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits ». Le plus important dans ce sabir, ce sont les mots « mesures destinées à empêcher la mise à disposition ». Pour être très clair : les industries culturelles voudraient obtenir que toute utilisation non souhaitée des œuvres dont elles détiennent les droits ne soit pas possible sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Snapchat et toute autre plateforme mondialisée à usage de masse. C’est le notice and stay down, « une façon détournée de dire que ce ne sont plus les utilisateurs d’un service qui sont responsables du contenu qui y est mis à disposition », analyse Julia Reda, la seule eurodéputée du Parti pirate, qui a travaillé sur un rapport préliminaire à cette réforme du copyright, enterré pour faire place à la baston entre YouTube et les ayants droit.
C’est cet article 13 qui pourrait, s’il survit aux débats parlementaires qui s’annoncent intenses, donner aux maisons de disques et aux sociétés de gestion des droits des auteurs comme la Sacem le pouvoir nouveau d’obliger YouTube à filtrer a priori, c’est-à-dire avant publication, tout contenu non souhaité, alors que YouTube ne doit aujourd’hui s’exécuter qu’après signalement d’un contenu déjà en ligne. Le spectre de ce filtrage pro-actif est large. Les reprises de Final Countdown au kazoo ? Dehors. Michelle Obama qui chante du Beyoncé dans une voiture ? Ouste ! Les disques pourtant indisponibles à la vente ou sur les plateformes de streaming ? Pareil, si quelqu’un, dans une maison de disques, le souhaite un matin en touillant son café.
Ce serait un changement d’ambiance majeur pour la circulation de la culture telle que nous la connaissons, et un sérieux coup de pression sur YouTube. Car même si aujourd’hui, seules 2 % des vidéos de la plateforme sont, selon son propriétaire Google, retirées à la demande d’ayants droit, ces derniers pourraient jouer le pourrissement avec cette nouvelle arme. « À un moment, si YouTube n’a plus de contenu intéressant à diffuser, ça sera problématique, m’a ainsi expliqué Xavier Blanc, le directeur des affaires juridiques et internationales de la Spedidam, une société de gestion des droits des interprètes qui observe le choc qui s’annonce pour y défendre les droits des musiciens. Ce qui attire les internautes, ce n’est pas le guitariste de génie qui va hyper vite, c’est majoritairement les contenus d’artistes connus, des émissions de télé, des concerts… Si tout ça est filtré, il ne restera pas grand-chose. » YouTube deviendrait alors ce que Lionel Maurel, de La Quadrature du Net, appelle « une télé 2.0 avec des chaînes bien contrôlées comme Vevo, parce que Google ne pourrait plus prendre le risque de laisser les gens uploader [mettre en ligne] des vidéos ».

Le secteur de la musique est de plus en plus chaud pour cette confrontation-là, avec pour objectif d’obliger YouTube à signer des contrats en direct qui seuls décideront de ses responsabilités envers lui. Dernièrement, c’est la Sacem qui s’est payé la plateforme lors d’une conférence sur le streaming où aucun représentant de Google n’avait répondu présent. Un acteur de la filière, qui veut rester anonyme vu l’ambiance actuelle, a senti la même tension qui monte : « Je pense que les ayants droit vont avoir de moins en moins de patience avec YouTube. Comme ils ont désormais la preuve qu’Apple Music et Spotify ramènent vraiment de l’argent, ils ne sont plus dans une confrontation entre le CD et les nouvelles technologies, mais entre les modèles vertueux et YouTube, qui est perçu comme détruisant de la valeur. À Londres, les mecs sont encore plus remontés que la Sacem… Ça fait deux des plus grosses sociétés de gestion du monde qui ont envie d’en découdre. »
Pour l’eurodéputée Julia Reda, le stay down est un compromis que la Commission a accepté « pour ne pas réformer le safe harbor, qui est la base du développement des services en ligne. Elle ne veut pas déstabiliser l’économie numérique… Mais on le transforme par derrière malgré tout ». Google s’est dit lui aussi opposé à toute remise en cause de ces principes fondateurs du business en ligne depuis quinze ans, que je détaillais dans l’épisode précédent. « Notre position, c’est qu’on ne pourrait pas opérer sans le safe harbor, m’a expliqué la firme américaine récemment, tout en me demandant de ne pas citer le nom de mon interlocuteur. C’est cette protection juridique qui nous permet de créer de la technologie comme Content ID. » Ce système de reconnaissance automatisée de contenu protégé par le droit d’auteur a été mis en place sur YouTube depuis 2008. Il permet notamment d’appliquer des publicités sur les vidéos et de rémunérer en retour les ayants droit.
Ce qu’on fait, c’est monétiser des utilisateurs qui ne s’abonneront jamais, qui ne payeront pas 10 euros pour Spotify. Or, on sait qu’une majorité des utilisateurs ne paieront jamais pour la musique.
Du côté de l’industrie de la musique, qui fait beaucoup de bruit dans cette affaire mais reste un petit poucet à côté du cinéma et de la télévision, « c’est pas non plus YouTube contre les producteurs, selon les mots de Guillaume Leblanc, le secrétaire général du Snep, syndicat français des majors du disque. YouTube est avant tout un partenaire, la première plateforme dans le monde et en France. Mais on ne travaille pas de manière assez serrée avec eux parce qu’il y a un problème de monétisation ». Le milliard d’utilisateurs mensuels de YouTube ne rapporte pas assez, on l’a vu dans l’épisode précédent, car son gâteau publicitaire est limité.
Google répond qu’on compare des pommes et des voitures, ou un truc dans le genre : « Ce qui est derrière l’inconfort de l’industrie, c’est le modèle publicitaire, car le système de l’abonnement crée plus de valeur. Mais ce qu’on fait, c’est monétiser des utilisateurs qui ne s’abonneront jamais, qui ne payeront pas 10 euros pour Spotify. Or, on sait qu’une majorité des utilisateurs ne paieront jamais pour la musique. » C’est en effet ce que l’histoire nous apprend, où une grande majorité des auditeurs se contentent sans problème d’écouter la radio, d’acheter un disque ou deux par an et de se payer un concert de temps en temps. Soit un panier moyen de 40 euros par an en France avant le tsunami internet, bien loin des 120 euros que dépense un abonné au streaming.

Mais pour le Snep et ses homologues, il faut quand même pousser les visiteurs de YouTube à payer, et sinon les pousser à déserter la plateforme pour aller s’abonner à Deezer ou l’un de ses concurrents. « C’est maintenant que l’usage de l’abonnement est en train de prendre, que le consentement à payer est en train de se démocratiser, avance Guillaume Leblanc. Mais on a un rapport déséquilibré entre des plateformes qui jouent le jeu et d’autres pas… On a des années de relations avec YouTube, donc on est en droit d’attendre davantage d’eux, qu’ils aient une communication plus agressive sur leur offre d’abonnement. » C’est-à-dire YouTube Red, pas lancé en France et foirade aux États-Unis avec 1,5 million d’abonnés seulement depuis son lancement fin 2014. Chez Sony France, Guillaume Quelet, vice-président en charge du numérique, voit lui aussi l’usage massif mais peu rémunérateur de YouTube comme « de la concurrence déloyale vis à vis de [leurs] autres partenaires, comme Apple ou Spotify ».
L’abonnement, c’est aussi la stratégie à moyen terme de Vevo, la plateforme de vidéos créée en 2009 par Universal, Sony, Google et Abu Dhabi Media, qui se confond largement avec YouTube pour un internaute lambda puisque tout Vevo est accessible depuis YouTube. Pourtant, les majors y sont bien plus chez elles en termes de contrôle et de partage des revenus. Or, il se trouve que la dernière des majors, Warner Music, a rejoint le catalogue en août, et Vevo expliquait alors pouvoir désormais « avancer vers le lancement d’un service sur abonnement ». La plateforme deviendrait alors, sur le papier, un Spotify des majors en vidéo.
Vevo a donc des velléités d’indépendance vis-à-vis de Google et YouTube, qui en ont assuré l’architecture technique depuis son lancement. La stratégie des grandes maisons de disques est aujourd’hui clarifiée sur ce point, telle que me l’a décrite Guillaume Quelet : « Tous les contenus officiels vont sur Vevo, avec sa régie pub à part. Sur YouTube, on ne s’occupe de monétiser que les vidéos déposées par les utilisateurs. » Les user generated contents, selon la terminologie de Google, c’est-à-dire toute séquence vidéo créée par un internaute : les reprises de Mariah Carey par des ados hésitants ou les décorations de Noël droguées sur Gangnam Style. C’est sur ces séquences inombrables que la bataille se concentre, et qui pourraient donc faire les frais de la nouvelle directive européenne sous influence.
Tout est foireux chez les ayants droit et 80 % de la responsabilité sur ces trous dans les revenus est chez eux.
Les ayants droit accusent non seulement YouTube de ne pas reverser assez pour cet usage de masse, mais aussi de les obliger, en s’abritant derrière le safe harbor, à demander sans arrêt le retrait de vidéos qui réapparaissent dans la minute. Selon Denis Ladegaillerie, le patron du distributeur de musique en ligne Believe, ils se trompent pourtant de combat. « Les user generated contents, c’est 50 % des revenus de YouTube pour nous aujourd’hui. » Si l’article 13 de la réforme du copyright parvient à modifier l’équilibre actuel entre YouTube et les maisons de disques, « on risque de tuer ce revenu qui ne fait que progresser ». Et Denis Ladegaillerie de servir en appui un argument que Google utilise aussi systématiquement : les annonceurs sont actuellement en train de migrer de la télévision et de la presse papier vers internet.
La situation est en fait moins limpide que ça. Tout d’abord, j’avais montré dans une enquête précédente (lire l’épisode 10 de la saison 1 de La fête du stream) que YouTube fuit de partout. Parce que Content ID est complexe à utiliser, parce que son système de repérage automatisé des œuvres a des failles, mais aussi parce qu’un mélange de conflits de territoires entre gestionnaires de droits et de négligence envers une partie de leur catalogue peu rentable laisse beaucoup d’argent en souffrance. J’avais à l’époque estimé que ce sont près de 50 % des vidéos qui sont ainsi touchées, et j’avais choisi la fourchette basse de cette estimation. « Tout est foireux chez les ayants droit et 80 % de la responsabilité sur ces trous dans les revenus est chez eux, estime encore aujourd’hui l’une de mes interlocutrices, qui connaît très bien le sujet. À la fin, l’argent reste chez Google. » Ces sommes en souffrance pourraient même servir d’arme à la firme américaine. « YouTube sait combien de millions d’euros ne sont pas réclamés, continue-t-elle. Ils peuvent tout à fait dire à la musique : “Vous êtes sympas, mais il y a X % de conflits non résolus en ce moment.” Si la bataille va sur le terrain de l’argent, YouTube a plein de cartouches. »

Pour Denis Ladegaillerie aussi, le secteur de la musique devrait commencer par balayer devant sa porte avant de se lancer dans ce combat contre plus gros que lui. « Une grande partie de l’industrie de la musique dit que Content ID ne fonctionne pas parce qu’elle n’a pas fait les investissements technologiques nécessaires ! Si on le fait, on a un niveau de contrôle suffisant. » J’ai demandé aux trois majors de me détailler leurs moyens placés dans la gestion des droits sur YouTube, ce traitement exigeant de big data qui seul permet un suivi fin de l’exploitation des œuvres. Sébastien de Gasquet, le directeur général adjoint d’Universal France, m’a répondu que l’entreprise « ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet ». Warner a fait le mort. Seul Sony, par la voix de Guillaume Quelet, a donné suite. « Le cœur de notre business, m’a-t-il dit, c’est de produire des artistes, de développer des carrières et de faire la promotion et le marketing de projets artistiques. À la fin, on arrive à la distribution de la musique et oui, aujourd’hui, on a développé cette expertise technologique. Après, est-ce qu’il y a des petites sociétés agiles capables de l’affiner, très probablement. Mais on parle de 10 % de revenus en France pour le streaming vidéo alors qu’il représente les deux tiers de la consommation totale en streaming… Si on passe à 12 %, tant mieux, mais à la fin ça ne fait toujours pas assez d’argent avec ce modèle économique. Notre relais de croissance, c’est l’abonnement. »
Cette baston qui s’annonce, si elle a lieu, sera de toute façon celle d’un vieux couple hyperdépendant, car les majors du disque se moquent en réalité un peu de ne récupérer qu’une partie de ce qui est dû à leurs artistes. Tout ça est un affichage médiatique, car elles ont, selon mes informations, signé avec YouTube un minimum garanti. Le même genre de parachute doré qui a été négocié avec des plateformes comme Deezer et Spotify et leur assure de ne jamais descendre sous un plancher annuel de revenus. Mais l’accord avec YouTube est un gros tabou dans la filière. En effet, aujourd’hui, les revenus des majors n’atteignent pas 50 % de ce minimum garanti sur YouTube, ce qui ne pousse personne à s’agiter pour améliorer sa technologie puisque ce sont quoi qu’il arrive des sommes qui entrent. Selon ces chiffres, et de façon bien entendu très approximative, les trois majors françaises qui bénéficient de ce minimum garanti auraient donc touché quelque 20 millions d’euros de YouTube en 2015, plutôt que les 10 millions affichés par le Snep. Ces sommes restent secondaires dans un marché français du numérique qui a représenté près de 136 millions d’euros pendant les huit premiers mois de l’année 2016, toujours selon les chiffres du Snep, mais elles relativisent les discours de chaque camp dans la confrontation actuelle.
À la fin, que veut donc la filière musicale en s’attaquant à son premier diffuseur ? Elle veut ce qu’elle a toujours voulu depuis qu’internet est venu saccager le modèle économique du disque : du contrôle. Le contrôle qu’elle a tenté de garder en attaquant tous les sites de partage de musique en ligne, en retardant la naissance d’une offre légale réellement dense, en retardant la mort du disque compact aussi, puis en signant avec les plateformes de streaming en échange de parts dans leur capital et d’un minimum garanti qui a ralenti leur développement. Avec l’obligation signifiée à YouTube de filtrer systématiquement les vidéos arrivant sur ses serveurs, « nous [aurions] le contrôle pour dire que nous ne voulons pas que nos œuvres soient sur YouTube », s’enthousiasmait ainsi récemment John Mottram, responsable des affaires publiques de la PRS, la Sacem britannique, lors d’une conférence consacrée à la réforme du copyright. Et ce serait la même chose sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter… Tout un monde ne serait plus accessible qu’en se pliant au modèle de l’abonnement qui ne plaît pourtant pas à tout le monde, loin de là. Tout cela, sans jamais se demander vraiment ce que veulent les internautes.
Mis à jour le 20 juin 2018 à 14 h 15. Ce 20 juin, la commission des Affaires juridiques de l’Union européenne a validé le projet de réforme de la directive « sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ». Un vote du Parlement en séance plénière est encore nécessaire pour ce nouveau paquet législatif qui pourrait, notamment via son article 13, changer en profondeur la circulation de la culture sur internet.