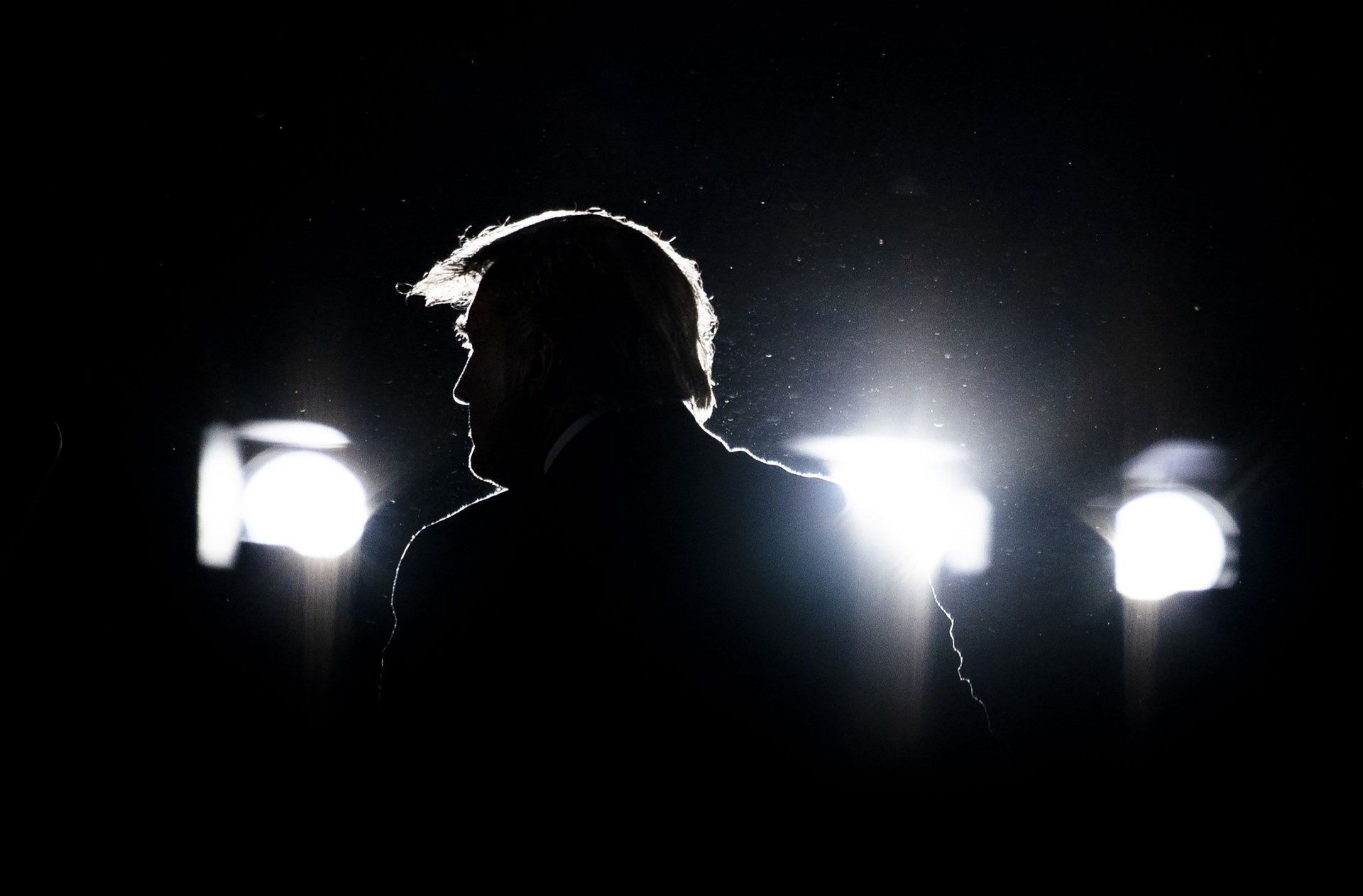Le 23 décembre 2021, Donald Trump a fait appel devant la Cour suprême, plus haute juridiction fédérale des États-Unis, afin qu’elle bloque la décision des cours inférieures de laisser certaines de ses archives présidentielles à disposition de la commission parlementaire d’enquête sur l’insurrection du 6 Janvier (lire l’épisode 12, « À Washington, enquête sur un Capitollé général »). C’est au moins la troisième fois que l’ancien Président se présente sans succès jusqu’alors devant ce juge de dernier ressort afin de se protéger d’enquêtes parlementaires ou judiciaires.
La réaction de Donald Trump à ces échecs successifs témoigne de la conception très particulière qu’il a de la Cour suprême. Depuis qu’il y a installé trois juges sur neuf (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett) avec la complicité du Sénat alors à majorité républicaine, Trump attend à chaque fois un renvoi d’ascenseur qui ne vient pas, et il exprime sa profonde déception, en contradiction avec l’esprit des institutions. Si les juges à la Cour suprême sont nommés à vie, c’est précisément pour éviter toute possibilité de tel trafic d’influence (lire l’épisode 13 de la saison 1, « Intrigues à la Cour suprême américaine »). Cela n’empêche pourtant pas Trump d’y retourner, d’abord pour une question de principe.

Car, à en croire Trump, depuis qu’il a annoncé refuser de collaborer avec la commission d’enquête parlementaire sur l’insurrection du Capitole, il veut faire prévaloir le privilège de l’exécutif.